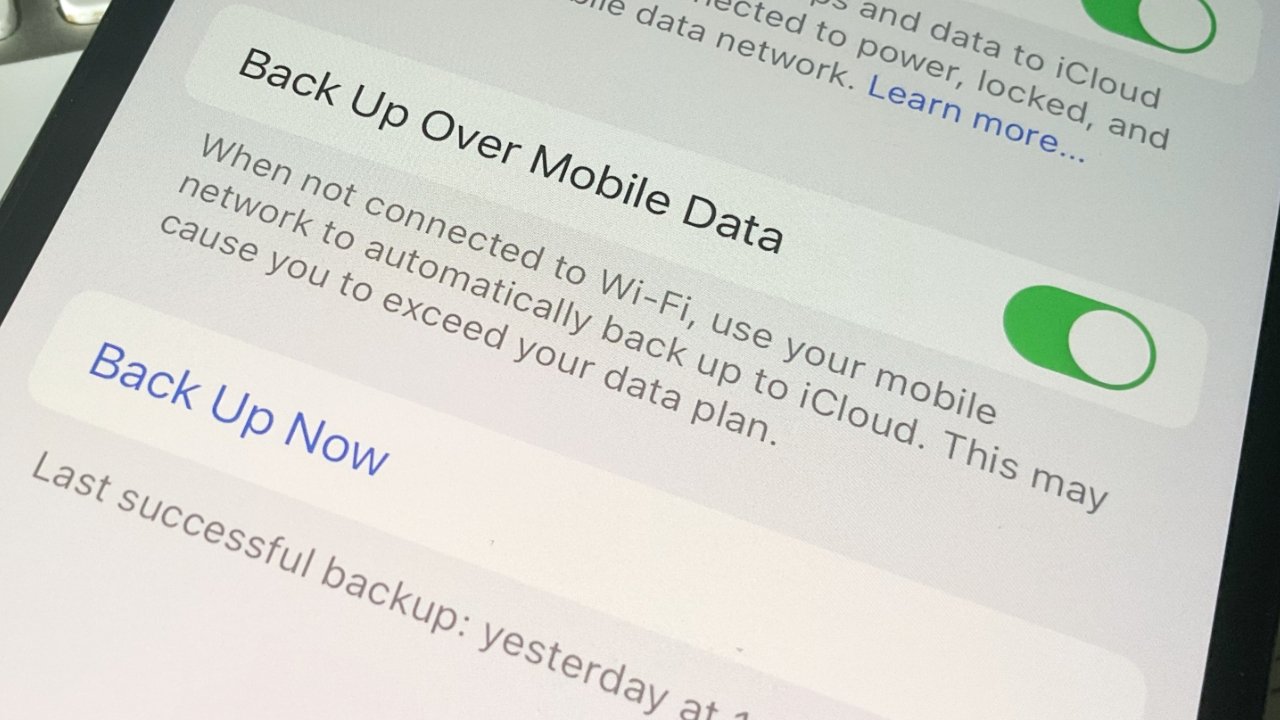– Commercial –
Depuis plusieurs décennies, les États-Unis ont occupé une place dominante au Moyen-Orient, influençant directement ou indirectement les conflits et les équilibres de pouvoir régionaux. Cependant, la stratégie américaine a connu plusieurs inflexions, notamment après l’échec des interventions directes en Irak et en Afghanistan. Le poids économique de la guerre, la lassitude de l’opinion publique américaine et l’émergence d’autres puissances, comme la Chine et la Russie, ont conduit Washington à revoir ses priorités. Sous l’administration actuelle, les États-Unis optent pour une approche plus sélective et pragmatique, visant à préserver leurs intérêts stratégiques sans pour autant s’engager massivement sur le terrain militaire.
Le recentrage des intérêts américains
La priorité de Washington reste la sécurité d’Israël et la stabilité des voies d’approvisionnement énergétiques. Pour cela, les États-Unis entretiennent des alliances solides avec les monarchies du Golfe, en particulier l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Ces pays jouent un rôle central dans la stratégie américaine, notamment en raison de leur poids économique et de leur capacité à garantir un équilibre face à l’Iran.
Cependant, la donne a évolué ces dernières années. L’Arabie saoudite, sous l’impulsion du prince héritier Mohammed ben Salmane, cherche à diversifier ses partenariats et s’est rapprochée de la Chine et de la Russie, ce qui fragilise l’emprise américaine. Pour compenser cette dynamique, Washington tente de maintenir son affect par des accords de défense et une coopération militaire accrue, notamment à travers des livraisons d’armements avancés.
La politique américaine vis-à-vis de l’Iran reste un enjeu central. L’administration actuelle a renforcé les sanctions économiques contre Téhéran et a imposé de nouvelles restrictions sur ses exportations pétrolières. Cependant, contrairement aux périodes de tensions extrêmes, Washington privilégie aujourd’hui une approche plus diplomatique, cherchant à contenir l’Iran sans pour autant s’engager dans une confrontation militaire directe. Cette stratégie contraste avec celle de l’administration précédente, qui avait opté pour un retrait de l’accord sur le nucléaire iranien et un retour à une pression maximale.
La Syrie : un engagement limité mais stratégique
En Syrie, la politique américaine a connu de nombreuses fluctuations. Initialement favorable à un soutien direct aux rebelles syriens contre le régime de Bachar al-Assad, Washington a progressivement réduit son engagement après la montée en puissance de la Russie et de l’Iran. Aujourd’hui, l’intervention américaine en Syrie se limite principalement à deux elements :
- Le maintien de troupes dans le nord-est syrien, où les forces américaines soutiennent les Forces démocratiques syriennes (FDS), une alliance kurde et arabe combattant les résidus de Daech. Cette présence vise également à empêcher une reprise totale du territoire par le régime syrien et ses alliés.
- Des frappes aériennes ponctuelles contre des cibles pro-iraniennes en Syrie et en Irak, visant à limiter l’affect de Téhéran dans la région.
Malgré ces engagements, il est clair que les États-Unis ne cherchent pas à jouer un rôle décisif dans la reconstruction ou la stabilisation de la Syrie. L’administration actuelle privilégie une approche de dissuasion et de contrôle, plutôt qu’une implication directe qui nécessiterait des ressources importantes et une présence prolongée.
Le Yémen : une place ambivalente
Le conflit yéménite illustre bien le changement de posture américaine. Pendant des années, Washington a soutenu l’intervention de la coalition menée par l’Arabie saoudite contre les rebelles houthis, en fournissant des armes, du renseignement et un appui logistique. Cependant, les pressions croissantes des ONG et de certains élus américains ont conduit à un réajustement de cette politique.
L’administration actuelle a ainsi annoncé l’arrêt du soutien aux opérations offensives saoudiennes au Yémen, tout en maintenant une coopération pour la défense du royaume face aux attaques de missiles houthis. Ce revirement s’inscrit dans une volonté de favoriser un règlement politique du conflit, tout en réduisant l’picture d’un soutien inconditionnel à Riyad.
Les États-Unis continuent néanmoins de considérer les Houthis comme une menace stratégique, notamment en raison de leurs liens avec l’Iran. Ainsi, Washington a maintenu une pression diplomatique et économique sur le groupe, tout en encourageant des négociations indirectes entre les différentes events.
Un désengagement militaire progressif ?
L’un des elements les plus marquants de la politique américaine au Moyen-Orient est la réduction progressive du nombre de troupes déployées dans la région. Après des décennies de présence militaire intensive en Irak, en Afghanistan et dans le Golfe, Washington cherche à limiter ses engagements sur le terrain, préférant miser sur des alliances locales et des frappes ciblées.
Cela ne signifie pas pour autant un retrait whole. Les bases américaines en Arabie saoudite, au Qatar et aux Émirats arabes unis restent opérationnelles et constituent des factors d’ancrage stratégiques. De plus, les ventes d’armes américaines aux pays du Golfe se poursuivent à un rythme soutenu, garantissant une présence indirecte et une affect sturdy.
L’administration actuelle met également un accent particulier sur les opérations de cyberdéfense et de guerre électronique, visant à contrer l’affect de la Chine et de la Russie dans la région. Cette nouvelle approche marque un changement necessary par rapport aux décennies précédentes, où la puissance militaire américaine reposait principalement sur la présence physique et les interventions directes.
Les défis de la politique américaine dans la région
Malgré sa volonté de réduire son engagement militaire direct, Washington doit composer avec plusieurs défis majeurs au Moyen-Orient :
- Le renforcement de l’affect chinoise et russe, qui offre aux pays de la région des options aux partenariats traditionnels avec les États-Unis.
- L’instabilité persistante en Irak et en Syrie, qui oblige les Américains à maintenir une surveillance et une capacité de réaction rapide.
- La montée des tensions avec l’Iran, qui pourrait à tout second dégénérer en confrontation ouverte.
- La complexité des relations avec l’Arabie saoudite et les Émirats, qui cherchent à jouer sur plusieurs tableaux pour maximiser leurs intérêts.
Washington doit donc naviguer dans un environnement géopolitique de plus en plus fragmenté, où son affect est remise en query par des acteurs émergents et des alliances en mutation.
L’offensive stratégique de la Russie
Les États-Unis, longtemps la puissance dominante au Moyen-Orient, ont amorcé un désengagement progressif, laissant un vide stratégique que d’autres puissances, notamment la Russie, cherchent à combler. Ce retrait ne signifie pas une disparition totale de l’affect américaine, mais plutôt un réajustement des priorités face à une région en pleine recomposition.
Cette nouvelle dynamique, où Washington privilégie des alliances locales et des interventions limitées, offre à la Russie une opportunité distinctive pour renforcer sa présence militaire et diplomatique. Moscou, en jouant habilement sur les failles de la stratégie américaine, s’impose désormais comme un médiateur incontournable, tout en consolidant ses propres intérêts.
De la prédominance américaine au repositionnement stratégique
Jusqu’au début des années 2010, les États-Unis étaient omniprésents dans les conflits du Moyen-Orient. Le renversement de Saddam Hussein en Irak, les interventions en Afghanistan, les opérations militaires en Libye et le soutien à Israël plaçaient Washington au cœur des décisions régionales.
Cependant, les résultats mitigés de ces engagements, conjugués aux coûts humains et financiers, ont provoqué une réorientation de la politique étrangère américaine. Le Moyen-Orient, autrefois au centre de l’agenda de Washington, a progressivement été relégué au second plan, derrière d’autres enjeux comme la montée en puissance de la Chine et la compétition avec la Russie en Europe de l’Est.
Sous l’administration actuelle, cette tendance s’accentue :
- Réduction du nombre de troupes américaines en Irak et en Syrie
- Moins d’implication dans la résolution des conflits régionaux
- Soutien oblique aux alliés du Golfe plutôt qu’une présence militaire huge
- Préférence pour les sanctions économiques et les pressions diplomatiques
Cette approche a créé une fenêtre d’opportunité pour Moscou, qui a su exploiter cette scenario pour s’établir comme un acteur clé du nouveau paysage moyen-oriental.
Le tournant syrien : l’entrée en scène de la Russie
L’un des symboles les plus marquants du désengagement progressif des États-Unis et de l’offensive stratégique russe est le conflit syrien. En 2011, alors que la guerre civile éclate, Washington et ses alliés occidentaux misent sur un effondrement rapide du régime de Bachar al-Assad. Des soutiens militaires et financiers sont apportés aux rebelles, tandis que l’Iran et la Russie se mobilisent pour défendre leur allié à Damas.
Toutefois, en 2013, lorsque l’administration américaine renonce à une intervention directe malgré l’utilization avéré d’armes chimiques par le régime syrien, la Russie prend la most important sur le file. Deux ans plus tard, Moscou déploie officiellement son armée en Syrie, effectuant des frappes aériennes massives contre les groupes rebelles.
Ce tournant marque un changement majeur dans la dynamique du Moyen-Orient :
- La Russie devient l’allié militaire principal du régime syrien.
- Les États-Unis, malgré une présence résiduelle, perdent leur affect sur l’subject du conflit.
- Le Kremlin installe durablement des bases militaires en Syrie, notamment à Hmeimim et Tartous.
À partir de ce second, la Russie s’impose comme un acteur succesful d’inverser le cours d’un conflit et de défier la suprématie américaine dans la région.
La doctrine russe : combler le vide laissé par les Américains
La stratégie de Moscou au Moyen-Orient repose sur un modèle d’intervention hybride, combinant présence militaire stratégique, diplomatie lively et coopérations énergétiques. Contrairement aux États-Unis, qui ont souvent basé leur présence sur des occupations longues et coûteuses, la Russie privilégie des interventions ciblées, des alliances souples et une affect à moindre coût.
Face au retrait progressif des États-Unis, Moscou joue sur plusieurs tableaux pour asseoir son affect :
- Médiateur en Syrie : tout en soutenant militairement le régime d’Assad, la Russie organise les négociations d’Astana, impliquant la Turquie et l’Iran, afin de contrôler le futur du pays.
- Partenaire alternatif des monarchies du Golfe : en misant sur des coopérations économiques et énergétiques, Moscou séduit l’Arabie saoudite et les Émirats, offrant une various à l’hégémonie américaine.
- Acteur militaire en Libye : par le biais du groupe Wagner, la Russie soutient Khalifa Haftar, consolidant son affect en Afrique du Nord.
- Interlocuteur stratégique au Yémen : bien que discrète, la Russie développe une diplomatie d’équilibre entre l’Arabie saoudite et les Houthis, facilitant des discussions là où les Américains sont perçus comme trop partisans.
Ce positionnement permet à Moscou de combler les vides laissés par le désengagement américain, tout en évitant les erreurs du passé, notamment les occupations longues et coûteuses qui ont miné Washington en Irak et en Afghanistan.
Syrie et Irak : deux terrains de confrontation indirecte
Le cas de la Syrie illustre parfaitement la confrontation indirecte entre Washington et Moscou. Alors que les États-Unis ont réduit leur engagement, laissant la place à des frappes ponctuelles, la Russie a installé un dispositif militaire everlasting dans le pays.
En Irak, la dynamique est plus subtile. Si le gouvernement irakien est historiquement lié à Washington, il se rapproche progressivement de Moscou, notamment sur le plan militaire. Les autorités de Bagdad, lassées des circumstances imposées par les Américains, ont commencé à acheter des armes russes et à négocier des contrats d’énergie avec Rosneft et Gazprom.
Ce basculement progressif traduit une perte d’affect américaine et un renforcement de l’ancrage russe, notamment dans la gestion des hydrocarbures et de la défense.
Une rivalité asymétrique entre Washington et Moscou
Contrairement à la guerre froide, où les États-Unis et l’Union soviétique s’opposaient frontalement, la compétition actuelle entre Washington et Moscou au Moyen-Orient est asymétrique.
- Les États-Unis restent la puissance dominante, avec des bases militaires et des alliances solides, mais leur affect s’érode progressivement.
- La Russie ne cherche pas à remplacer Washington, mais plutôt à exploiter chaque faille laissée par le désengagement américain pour s’implanter durablement.
- La diplomatie russe est plus souple, lui permettant de naviguer entre plusieurs camps là où les États-Unis sont souvent perçus comme trop alignés sur certaines puissances.
Cette confrontation indirecte façonne le nouvel ordre stratégique du Moyen-Orient, où la Russie s’impose non pas comme un acteur hégémonique, mais comme une various crédible à l’affect américaine.
L’ascension chinoise : une affect économique grandissante au Moyen-Orient
Alors que la rivalité entre les États-Unis et la Russie façonne les équilibres géopolitiques du Moyen-Orient, un autre acteur se positionne de manière plus subtile mais non moins déterminante : la Chine. Contrairement aux deux autres puissances, Pékin n’adopte pas une approche militaire ou interventionniste. Son affect repose sur l’économie, le commerce, l’énergie et la diplomatie.
Longtemps en retrait sur la scène moyen-orientale, la Chine a progressivement tissé des liens solides avec les pays de la région, exploitant les opportunités offertes par la lassitude des partenaires traditionnels vis-à-vis de Washington et l’incapacité de Moscou à proposer des options économiques crédibles. Pékin n’est pas un acteur secondaire : son empreinte s’étend des marchés pétroliers aux infrastructures stratégiques, en passant par les nouvelles applied sciences et la coopération militaire naissante.
Les Routes de la Soie : la clé de l’growth chinoise
L’un des piliers de l’affect chinoise au Moyen-Orient repose sur l’initiative des Nouvelles Routes de la Soie (Belt and Highway Initiative, BRI), un programme massif lancé par Pékin visant à connecter l’Asie, l’Afrique et l’Europe à travers des infrastructures commerciales et logistiques. Cette stratégie englobe le développement de ports, de chemins de fer, d’autoroutes et de corridors énergétiques à travers le Moyen-Orient.
Plusieurs États de la région sont désormais des partenaires majeurs de cette initiative :
- L’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, où la Chine investit massivement dans des projets portuaires et énergétiques.
- L’Irak, où Pékin finance la reconstruction des infrastructures détruites par la guerre.
- L’Iran, avec qui la Chine a signé un accord stratégique de 25 ans prévoyant des investissements massifs en échange d’un accès privilégié au pétrole iranien.
- L’Égypte, qui accueille des projets chinois dans la modernisation du Canal de Suez et du port d’Ain Sokhna.
Cette approche permet à la Chine d’ancrer sa présence économique de manière sturdy, en s’assurant que ses investissements lui offrent une affect stratégique à lengthy terme.
L’énergie au cœur des relations sino-moyen-orientales
Si la Chine mise sur les infrastructures, son besoin énergétique colossal est également un moteur clé de son engagement au Moyen-Orient. Pékin est aujourd’hui le premier importateur de pétrole de la région, surpassant largement les États-Unis.
Les monarchies du Golfe, autrefois tournées exclusivement vers Washington, ont progressivement intensifié leur coopération avec Pékin :
- L’Arabie saoudite exporte plus d’un quart de son pétrole vers la Chine, ce qui en fait son principal consumer.
- Les Émirats arabes unis et le Koweït suivent une tendance similaire, renforçant leurs liens commerciaux avec Pékin.
- L’Iran, sous sanctions occidentales, s’est tourné vers la Chine pour écouler son pétrole à des prix préférentiels.
La Chine ne se contente pas d’acheter du pétrole. Elle signe des contrats de partenariat énergétique, investit dans le développement de raffineries et finance des projets d’extraction en Irak et en Iran. Cette approche guarantee à Pékin un approvisionnement sécurisé, tout en renforçant sa place face aux États-Unis, qui voient leur affect économique régionale s’éroder.
Une affect technologique grandissante
Au-delà des infrastructures et de l’énergie, la Chine étend son empreinte dans le domaine des applied sciences avancées et de la cybersécurité. Plusieurs États du Moyen-Orient ont noué des accords de coopération numérique avec des entreprises chinoises, notamment dans les domaines de la 5G, de l’intelligence artificielle et de la surveillance.
- Huawei a signé des contrats avec plusieurs pays du Golfe pour le déploiement des réseaux 5G, malgré les pressions américaines visant à limiter son growth.
- Des accords sur la reconnaissance faciale et la surveillance ont été conclus avec des gouvernements cherchant à renforcer le contrôle de leur inhabitants.
- Pékin offre une various aux applied sciences occidentales, évitant aux États de la région d’être dépendants des infrastructures américaines ou européennes.
Cette présence technologique pose un dilemme pour les États-Unis, qui tentent de dissuader leurs partenaires arabes d’intégrer les systèmes chinois, mais sans réel succès face à la compétitivité des offres chinoises.
Une diplomatie discrète mais efficace
Contrairement aux États-Unis et à la Russie, la Chine adopte une stratégie de non-ingérence politique au Moyen-Orient. Pékin ne cherche pas à imposer de modèle politique ou à s’impliquer dans les conflits internes des pays de la région. Cette neutralité relative est particulièrement appréciée par des États qui souhaitent diversifier leurs alliances sans subir de pressions idéologiques.
Pékin a ainsi réussi à maintenir d’excellentes relations avec des ennemis jurés, comme :
- L’Arabie saoudite et l’Iran, en jouant un rôle de médiateur sur certains dossiers.
- Israël et la Palestine, en développant des liens économiques avec Tel-Aviv tout en soutenant la trigger palestinienne à l’ONU.
- La Turquie et l’Égypte, avec qui elle développe des relations commerciales sans se mêler de leurs conflits politiques.
Cette approche pragmatique permet à la Chine de se poser en partenaire fiable, sans s’exposer aux controverses qui affaiblissent souvent les relations entre les pays occidentaux et le Moyen-Orient.
Une coopération militaire en développement
Si la Chine reste discrète militairement au Moyen-Orient, elle start à renforcer ses coopérations en matière de défense. Pékin a signé plusieurs accords d’armement avec des pays de la région, notamment :
- Des ventes de drones à l’Arabie saoudite et aux Émirats, contournant les restrictions américaines.
- Des exercices militaires conjoints avec l’Iran, illustrant un rapprochement stratégique.
- Le développement d’une base logistique en mer Rouge, suscitant l’inquiétude de Washington.
Bien que la Chine ne cherche pas à concurrencer la présence militaire américaine, ces initiatives montrent qu’elle est prête à jouer un rôle plus actif en matière de sécurité régionale, en fonction de ses intérêts.
Vers un Moyen-Orient multipolaire
L’arrivée en drive de la Chine au Moyen-Orient marque une nouvelle étape dans la recomposition stratégique de la région. Longtemps dominée par l’affect américaine, contestée par l’activisme militaire russe, la région voit désormais émerger un troisième pôle d’affect, basé sur l’économie, l’énergie et les applied sciences.
Contrairement aux interventions militaires et aux alliances rigides des États-Unis et de la Russie, Pékin suggest un modèle basé sur la coopération économique et technologique, sans ingérence directe. Cette approche séduit de nombreux pays qui cherchent des options aux dépendances historiques et qui veulent s’inscrire dans une logique plus versatile et pragmatique.
Si cette montée en puissance chinoise ne signifie pas un effacement des États-Unis ou de la Russie, elle modifie en profondeur les rapports de drive, ouvrant une nouvelle ère de rivalités et de recompositions stratégiques au Moyen-Orient.
La Turquie : une puissance régionale qui inquiète ses voisins
Alors que les États-Unis réduisent leur empreinte et que la Russie et la Chine renforcent leur affect au Moyen-Orient, la montée en puissance de la Turquie start à inquiéter de nombreux acteurs régionaux, qu’ils soient arabes ou israéliens. Si Ankara tente de projeter une picture de puissance stabilisatrice, ses ambitions et ses interventions militaires sont perçues comme une menace potentielle par plusieurs gouvernements.
D’une half, la Turquie poursuit une politique expansionniste qui vise à renforcer son affect dans des pays autrefois sous contrôle ottoman. D’autre half, elle maintient des liens ambigus avec les mouvements islamistes, notamment les Frères musulmans, ce qui exacerbe les tensions avec plusieurs États arabes, notamment l’Arabie saoudite, l’Égypte et les Émirats arabes unis.
Une inquiétude croissante dans le monde arabe
Le rôle grandissant de la Turquie au Moyen-Orient ne plaît pas aux monarchies du Golfe ni à l’Égypte, qui voient en elle une menace pour l’ordre établi.
- L’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis perçoivent l’activisme turc comme une tentative de remettre en trigger leur affect régionale, notamment par le soutien d’Ankara aux Frères musulmans et au Qatar, leur rival stratégique.
- L’Égypte, sous Abdel Fattah al-Sissi, considère la Turquie comme un soutien direct aux mouvements islamistes opposés à son régime. Le président égyptien accuse régulièrement Ankara d’alimenter l’instabilité en soutenant des groupes islamistes, notamment en Libye et en Syrie.
- La Syrie de Bachar al-Assad voit en la Turquie un occupant et un adversaire direct, en raison de sa présence militaire dans le nord du pays et de son soutien aux factions rebelles anti-Assad.
Les monarchies du Golfe et l’Égypte reprochent à la Turquie d’utiliser l’idéologie des Frères musulmans pour étendre son affect politique et culturelle. Contrairement à la Russie ou à la Chine, qui misent sur la stabilité et la diplomatie pragmatique, la Turquie est accusée de vouloir remodeler l’ordre régional en promouvant une imaginative and prescient islamiste du pouvoir.
Ce positionnement a conduit à une dégradation progressive des relations entre Ankara et plusieurs capitales arabes, bien que des tentatives de réconciliation aient récemment émergé.
Israël face à l’ambiguïté turque
La montée en puissance de la Turquie inquiète également Israël, qui observe avec méfiance les ambitions régionales d’Ankara.
Officiellement, la Turquie et Israël entretiennent des relations diplomatiques et économiques, malgré des tensions récurrentes. Mais dans les faits, Ankara adopte une posture ambiguë :
- Elle critique régulièrement la politique israélienne à l’égard des Palestiniens, notamment à Gaza, où elle apporte un soutien humanitaire et financier au Hamas.
- Elle entretient des liens avec des groupes islamistes hostiles à Israël, notamment by way of les Frères musulmans et certaines factions syriennes opposées au régime d’Assad.
- Elle cherche à renforcer son affect à Jérusalem-Est, en finançant des projets culturels et religieux visant à soutenir la présence musulmane face aux initiatives israéliennes.
Cette double approche met Israël dans une place délicate. D’un côté, Tel-Aviv voit en la Turquie un partenaire économique necessary, notamment en matière d’échanges commerciaux et de coopération énergétique. De l’autre, elle redoute l’activisme turc dans la région et s’inquiète du rapprochement d’Ankara avec l’Iran et certaines factions islamistes.
Israël reste cependant prudent dans ses critiques, évitant une confrontation directe avec Ankara tout en renforçant ses alliances avec les pays arabes hostiles à la Turquie, comme l’Égypte, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis.
Les Frères musulmans, un outil d’affect turc
L’un des elements les plus controversés de l’growth turque au Moyen-Orient est son soutien aux Frères musulmans, un mouvement islamiste présent dans plusieurs pays arabes.
Historiquement, les Frères musulmans ont entretenu des liens étroits avec la Turquie, qui les considère comme un allié idéologique et politique dans sa quête d’affect régionale.
- En Égypte, le président déchu Mohamed Morsi, issu des Frères musulmans, était proche du gouvernement turcavant d’être renversé par un coup d’État militaire en 2013. Depuis, la Turquie accueille de nombreux exilés politiques égyptiens affiliés à la confrérie, ce qui irrite profondément le Caire.
- En Libye, Ankara a soutenu le gouvernement de Tripoli, où plusieurs figures influentes sont liées aux Frères musulmans, renforçant les tensions avec les pays du Golfe qui appuient le camp opposé.
- En Syrie, les factions rebelles soutenues par la Turquie comptent dans leurs rangs de nombreux combattants affiliés à des mouvements islamistes, certains inspirés des Frères musulmans.
Le soutien turc aux Frères musulmans constitue un level de friction majeur avec l’Arabie saoudite, les Émirats et l’Égypte, qui considèrent la confrérie comme une organisation terroriste cherchant à déstabiliser leurs régimes.
Une présence militaire qui dérange
Outre son affect politique et religieuse, la Turquie projette sa puissance militaire de manière plus agressive que la Chine et la Russie. Ses opérations en Syrie, en Libye et en Irak inquiètent de nombreux pays, qui y voient une tentative d’growth néo-ottomane.
- En Syrie, la Turquie contrôle plusieurs zones du nord du pays, où elle impose une administration pro-turque, modifiant la démographie locale et poussant à l’intégration de la livre turque dans les échanges commerciaux.
- En Libye, Ankara a envoyé des soldats et des mercenaires syriens pour soutenir le gouvernement de Tripoli, ce qui a suscité des condamnations de la half de plusieurs pays arabes.
- Dans le Caucase, la Turquie a soutenu militairement l’Azerbaïdjan contre l’Arménie, consolidant ainsi son affect dans une région stratégique.
Cette multiplication des interventions militaires fait de la Turquie un acteur de plus en plus imprévisible, succesful de défier aussi bien les États-Unis que la Russie, tout en exacerbant les tensions avec ses voisins arabes et Israël.
Une puissance en ascension mais fragile
Si la Turquie a réussi à se positionner comme un acteur incontournable au Moyen-Orient, son growth reste fragile.
- Son économie est sous pression, notamment en raison des sanctions occidentales et de la dévaluation de la livre turque.
- Ses interventions militaires lui valent de nombreuses critiques, y compris au sein de l’OTAN.
- Ses relations avec la Russie et l’Occident sont instables, oscillant entre coopération et confrontation.
Pour Ankara, le défi des prochaines années sera de pérenniser son affect sans provoquer une opposition frontale de ses voisins.
Le Moyen-Orient entre dans une nouvelle ère multipolaire, où la Turquie tente de s’imposer comme un joueur de premier plan, malgré les résistances et les tensions qu’elle suscite.
– Commercial –




![[SaveUs] Tilt your phone… [SaveUs] Tilt your phone…](https://external-preview.redd.it/NzlvYjZ1eHJlMXNlMfjlwkFWX-3Da_vscECei0u7rvsEn3F1e0iq_6Dl7ruH.png?width=640&crop=smart&auto=webp&s=a978d14dcc4627eaf40423d0e9e9595ec1dc4b16)